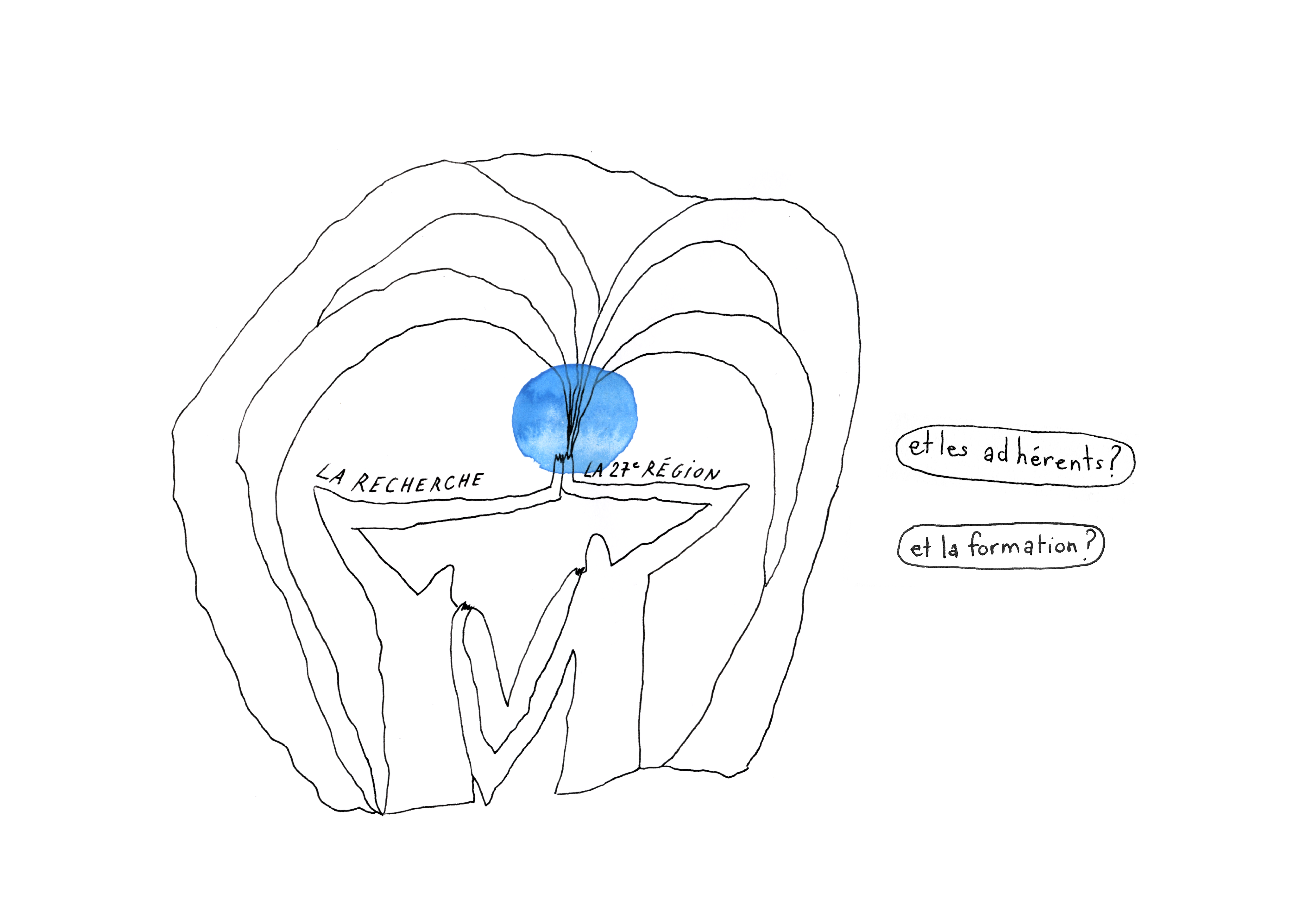
Cet article s’inscrit dans une série visant à décrire les transformations que nous tentons de mener à la 27e Région pour cultiver ce qui fait, nous semble-t-il, notre force et notre utilité : le développement des compétences, des capacités et des ressources transformatrices au sein des organisations publiques; la création et l’animation dans la durée de coalitions réunissant des collectivités, des acteurs privés et des chercheurs de différents territoires, pour les faire progresser ensemble autour d’un problème public; la mobilisation de collectifs pluridisciplinaires articulant recherche et action, pour traiter des enjeux toujours plus complexes et produire une connaissance opérationnelle.
***
Après un premier article sur la relation avec nos adhérents, c’est aujourd’hui la place de la recherche que nous aimerions aborder. En effet, la recherche et les sciences humaines et sociales ont toujours tenu un rôle essentiel à la 27e Région, mais celui-ci a évolué avec le temps. Nous l’avons d’abord pensé comme une des composantes importantes de nos activités et de nos programmes. Aujourd’hui, nous y voyons un sujet majeur de coopération entre le monde des pouvoirs locaux et celui de la recherche – à rebours de la guerre contre la science à laquelle on assiste actuellement de l’autre côté de l’Atlantique, mais qui commence à atteindre nos côtes…
La recherche dans nos premières années
Lancé en 2008, notre premier programme « Territoires en résidences » faisait la part belle à des problématiques de politiques territoriales. Nous menions des résidences en immersion dans des quartiers, des lycées, des gares rurales, des administrations de proximité… Ce n’est donc pas un hasard si dans le cadre de ces résidences nous avons d’abord croisé la route de géographes un peu atypiques, comme Martin Vanier ou Luc Gwiazdzinski -qui a ensuite décidé de sensibiliser ses élèves à ce type d’approche. Nous avons également commencé à accueillir de jeunes chercheuses et chercheurs dans nos équipes de résident.e.s, par exemple la politiste Lucie Bargel, ou encore le sociologue et anthropologue Boris Chevrot, à l’époque doctorant au sein de la Communauté de communes du Clunisois. Nous avons crée une fonction de veille tournée vers la recherche -avec le recrutement d’Anna Lochard- mais nous avons ensuite échoué à créer un poste en CIFRE au sein de la 27e Région.

L’innovation publique comme sujet de recherche
Après plusieurs années d’expérience, nos approches ont commencé à intéresser la recherche. Entre 2014 et 2017, les méthodes d’innovation publique par le design ont fait l’objet d’un projet de recherche fondamentale appelé FIP-EXPLO, coordonné par Frédérique Pallez, rassemblant respectivement Nadia Arab, Emmanuel Coblence, Olivier Hirt, Philippe Lefebvre, Apolline Le Gall, Anna Lochard, Burcu Ozdirlik, Elsa Vivant et Jean-Marc Weller. Les partenaires institutionnels comprenaient Mines ParisTech, l’Université Paris Est Marne la Vallée, l’École Nationale Supérieure de la Création Industrielle et la 27e Région. Ces travaux visaient à mieux comprendre les nouvelles formes d’innovation publique, à identifier leurs bénéfices et leurs limites.
Peu après, des chaires spécialisées ont été créées pour approfondir ces questions : la chaire Innovation publique à Paris, et la chaire Transformations de l’action publique à Sciences Po Lyon. Dix ans plus tard, de notre côté nous continuons à questionner l’innovation publique avec des universitaires, par exemple Mathias Bejean de l’UPEC dans le cadre du programme Les Labonautes, ou la chercheuses canadienne Lindsay Cole de l’Université de Vancouver avec le programme de recherche Repousser les frontières de l’innovation publique.
Vers des formes participatives de recherche
Avec des programmes comme La Transfo, nous avons réalisé que notre plus-value consistait à fédérer des groupes d’agents -voire d’élu.es- de différentes collectivités autour de démarches combinant co-production de savoirs et effort de transformation. Le modèle dont nous nous inspirons est celui de la recherche action participative (RAP). Des chercheuses et chercheurs sont maintenant associés à la quasi-totalité de nos programmes, comme Rebonds (avec Magali Talandier), mais aussi Juristes embarqués, Nouvelles Mesures (avec la chaire de comptabilité écologique), ou Nouveaux Accords (avec les consultant.e.s-chercheur.euses Manon Loisel et Nicolas Rio). Nous participons régulièrement à la publication d’articles de recherche ou à des revues savantes (sciences du design, société française d’évaluation, etc), et nous voulons y contribuer encore plus à l’avenir.
Plus de coopération entre recherche et collectivités
Maintenant que nous maîtrisons mieux l’alchimie de leur montage, notre objectif est de populariser ces formes de recherche « hybrides » (recherche-action participative, mais aussi R&D sociale telle que promue par nos amis d’Ellyx) auprès des collectivités et des chercheuses et chercheurs. Les choses bougent du côté des collectivités : elles cherchent à ré-internaliser les compétences dans un contexte de pression budgétaire, à être moins dépendantes des grands cabinets conseil. C’est pourquoi beaucoup essaient d’accueillir de jeunes chercheuses et chercheurs et, pour les plus grandes d’entre elles, de travailler avec des universités et des laboratoires de recherche sur des enjeux toujours plus complexes, notamment liés à la transition écologique -comme c’est le cas du programme IRIS-E à Rennes, des Zones Atelier Environnementale urbaine (ZAEU) à l’Eurométropole de Strasbourg, mais aussi à Nantes, Grenoble, Nancy, et dans des dizaines de Living labs universitaires, boutiques des sciences, etc.
Et maintenant, comment aller plus loin ?
Les volontés sont là, mais favoriser une véritable coopération recherche-collectivités n’est pas un long fleuve tranquille. Il reste beaucoup à faire pour changer les représentations, rendre la recherche plus accessible (notamment aux petites collectivités), lever les malentendus et créer une culture commune entre le monde de la recherche et celui des acteurs publics. Quel rôle pourrions-nous jouer dans ce sens, côté 27e Région ? Nous avons commencé à poser les bases d’un tel enjeu, en publiant une tribune dans la nouvelle revue Interlignes, mais aussi en rédigeant avec une trentaine de chercheuses, chercheurs et agents publics une première liste de conseils à l’attention des collectivités, et prochainement une seconde à l’attention des chercheuses et chercheurs.
Pour soutenir un tel mouvement, nous devons nous-mêmes consolider nos liens avec la recherche, dans plusieurs directions.
Mieux comprendre l’écosystème de la recherche
Aujourd’hui, quand nous travaillons avec des chercheuses et chercheurs c’est le plus souvent hors du cadre de leurs laboratoires. Nous avons encore beaucoup à apprendre des institutions de la recherche et de leur fonctionnement, tout spécialement dans le champ des sciences participatives et de la recherche action. Nous pouvons le faire en nous rapprochant de structures qui nous ressemblent (POPSU, le GIP EPAU, etc.), ou encore des GIECS locaux. En retour nous pouvons leur être utile pour intégrer davantage les enjeux de transformation publique dans leurs programmes de recherche, comme nous le faisons avec le programme Resyst actuellement.
A l’échelle européenne, nous devons nous rapprocher des services Europe et partenariats des grandes collectivités (Métropoles, Régions) pour mieux accéder aux programmes européens, dont Horizons Europe et son volet « Sciences et société », et voir comment nous pouvons participer en amont de l’élaboration des projets soumis aux financements européens.
Mieux anticiper les futurs programmes de recherche
Nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir ponctuellement sur le volet « transformation publique » de programmes de recherche (par exemple par l’INRAE et leur programme Becreative sur la réduction de l’usage des phosphates, ou bien l’Université de Rennes avec IRIS-E sur les politiques de transition). L’enjeu pour nous serait d’être associés plus en amont, lorsque ces programmes sont en discussion et que nous pouvons encore jouer un rôle sur le choix des objectifs et les modalités du programme.
Pour cela nous devons nous rapprocher des bons contacts au sein des instituts de recherche (ex INRAE pour le PEPR Forest dans le cas de Tronc Commun) et des universités, identifier les laboratoires de recherche susceptibles de porter des programmes qui nous intéressent, une sélection de chaires de recherche, mais aussi les services enseignement supérieur des grandes collectivités.
Mieux accéder aux financements de la recherche
Même si les équipes en charge des sciences participatives de l’Agence Nationale de la Recherche nous voient comme de potentiels partenaires, la recherche participative reste marginale et peu soutenue au sein de l’institution. De plus, n’étant pas identifié comme un organisme de recherche, peu de financements émanant de la recherche nous sont directement accessibles, contrairement à certains appels à projets « recherche » d’autres agences de l’Etat (ADEME, ANCT…). Néanmoins nous devons chercher à mieux comprendre les rouages de tous ces financements. Enfin, à beaucoup plus long terme nous devons continuer à suivre l’idée du CIR Social porté par Ellyx, et dont l’objectif serait de financer l’effort de recherche appliquée de structures sans but lucratif comme la 27e Région.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Nous avons besoin de vos conseils, contacts et idées !
Quelques unes de nos ressources pour aller plus loin :
7 conseils pour mieux travailler avec la recherche quand on est une collectivité
https://www.la27eregion.fr/comment-mieux-travailler-avec-la-recherche-quand-on-est-une-collectivite/
Un plaidoyer pour la coopération recherche/collectivités pour la revue Interlignes
Entretien avec la chercheuse Lucie Laluque : mieux comprendre la recherche-action
https://www.la27eregion.fr/mieux-comprendre-la-recherche-action/
Journée organisée par la DITP : « La recherche pour l’action publique : comment améliorer le service public grâce à la science et à l’expérimentation ? »
Le compte-rendu d’une journée « les chercheurs et l’action » organisée à la Maison des Sciences de l’Homme
https://www.la27eregion.fr/les-chercheurs-et-laction-retours-sur-une-matinee-dechanges/
Une forme hybride de recherche : la R&D sociale
https://www.la27eregion.fr/vers-des-ecosystemes-de-rd-publique-et-sociale/
Comment continuer à faire de la recherche en période de confinement ?
https://www.la27eregion.fr/comment-faire-de-la-recherche-utilisateur-en-periode-confinement/



